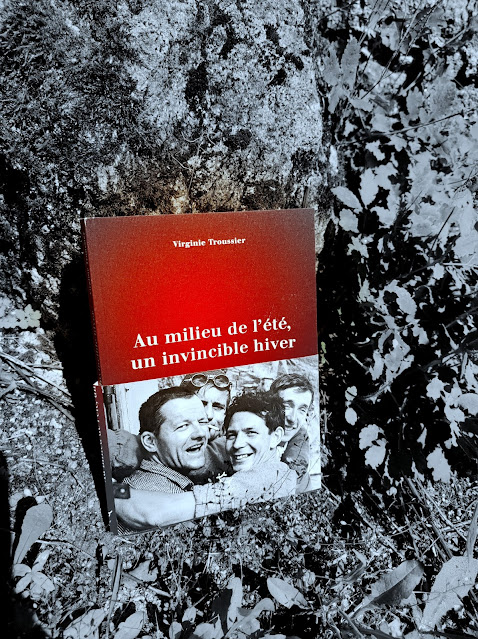Une noisette, un livre
Un si beau siècle, la poésie contre les écrans
Olivier Frébourg
Et si Olivier Frébourg était un nouveau Don Quichotte ? Intrépide et ne cédant en rien au politiquement correct face à une invasion d’armes de destruction massive, celles-ci soi-disant conventionnelles sans que cela fasse réagir quelconque organisation non gouvernementale : les écrans. Même si la ligne rouge risque d’être franchie, l’écrivain éditeur propose un remède, lui aussi universel avec une efficacité restée et approuvée : la poésie avec un ingrédient majeur, la beauté. Un antidote testé depuis l’antiquité : « Les Grecs nous ont appris la magnificence de l’instant pur, de la jouissance du présent. Les Romains les ont suivis sur cette voie. « Laetus in praesens animus » (Horace). Et cette beauté de l’instant ne doit pas nous être ravie ».
Un ouvrage précieux qui se lit avec lenteur pour savourer les envolées scripturales, les nombreuses citations et découvrir que l’on peut transformer l’encre en velours même lorsque d’aucuns s’attachent à inscrire sur papier leur esprit d’acier. Néanmoins, votre serviteur est loin d’être aussi révoltée contre les ordinateurs et autres smartphones, ces appareils ayant un côté salutaire pour qui les utilise avec sagesse et bienveillance. Ironie du sort, ma chronique se sera visible que sur écran et peut-être n’aurais-je jamais eu ce livre entre les mains – pardon les pattes – sans les réseaux sociaux.
Véritable plaidoyer pour un retour aux relations humaines, au goût du contact, à l’authenticité, Olivier Frébourg navigue sur les vers poétiques, Baudelaire, Apollinaire, La Fontaine, Villon, Becker, Rimbaud – coucou Sylvain Tesson – Pessoa…, tout en dressant un tableau des maux de notre siècle qui s’éloigne des mots. Le tout en rendant hommage aux livres, aux bibliothèques, à la littérature en particulier et à l’art en général. Un appel pour retrouver la beauté du monde, pour renouer chaque destin à ce qui fait la vraie vie, à rejeter cette laideur du voyeurisme sociétal. Avec une bonne claque à cette horrible expression et directive de l’ « obsolescence programmée.
Cet ouvrage est aussi un voyage. Une excursion en dehors des chemins que l’on veut tracer à notre place, une balade sur des sentiers bordés des petites choses de la vie et qui méritent bien plus notre regard, une navigation pour s’éloigner des carcans imposés, une escalade vers la beauté en s’agrippant à ce qui reste le plus solide de tout : notre capacité à ne pas effriter les précieuses roches de l’onirisme. Même si les outils numériques restent un élément incontournable, ne pas céder à l’enfermement et s’évader vers des ondes enivrantes, celles de la liberté.
« C’est un corps chaud qui palpite, une bibliothèque, pas une rangée d’astres morts (…) Les bibliothèques composent une mémoire vivante, un éveil des sens. Elles permettent de voyager d’un pays à l’autre (…) Les livres gardent entre leurs pages la douceur du temps suspendu ».
« Quand le livre s’efface, une part de la civilisation recule (…) Quand le livre s’efface, l’esprit de résistance s’effondre ».
« Sans imaginaire, nous sommes des papillons épinglés, dépourvus de passion ou de rêve ».
« A l’époque des écrans et du virus, le pistage et le dépistage furent les deux sillages de ces jours de défaite. Les écrans produisent l’anomie. La distanciation sociale a commencé à partir de l’invasion des écrans dans les foyers. La télévision, bien sûr, puis les ordinateurs et smartphones qui nous ont tous mis à l’isolement comme dans les anciens quartiers de sécurité des prisons ».
« La poésie est le ressac de l’océan »
« En une génération, le monde financier a pompé notre énergie vitale ».
« Les écrans de télévision, les chaînes mondialisées par satellite ne mettent jamais en avant le beau. Le mal fait vendre et exploser les audiences ».
« Les poèmes comme les fados sont des pavillons de toutes les couleurs contre la noire barbarie ».
« La poésie est une convocation au banquet de la vie ».
Un si beau siècle, la poésie contre les écrans – Olivier Frébourg – Editions des Equateurs – Juin 2021